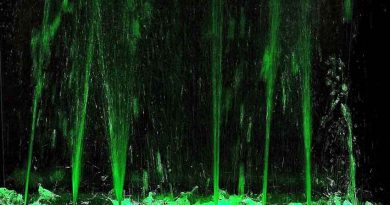Lettre sur le pays des Kabyles en 1837
Quant aux Kabyles[1], il est visible qu’il ne saurait être question de conquérir leur pays ou de le coloniser : leurs montagnes sont, quant à présent, impénétrables à nos armées et l’humeur inhospitalière des habitants ne laisse aucune sécurité à l’Européen isolé qui voudrait aller paisiblement s’y créer un asile.
Le pays des Kabyles nous est fermé, mais l’âme des Kabyles nous est ouverte et il ne nous est pas impossible d’y pénétrer.
Quant aux Kabyles, comme ils étaient à peu près indépendants des Turcs, la chute des Turcs ne produisit que peu d’effets sur eux. Ils restèrent vis-à-vis des nouveaux maîtres dans une habitude à peu près analogue à celle qu’ils avaient prise vis-à-vis des anciens. Seulement ils devinrent encore plus inabordables, la haine naturelle qu’ils avaient des étrangers venant à se combiner avec l’horreur religieuse qu’ils éprouvaient pour les chrétiens dont la langue, les lois et les mœurs leur étaient inconnues.
Les hommes se soumettent quelquefois à la honte, à la tyrannie, à la conquête, mais ils ne souffrent jamais longtemps l’anarchie. Il n’est point de peuple si barbare qu’il échappe à cette loi générale de l’humanité.
Quand les Arabes, que nous cherchions souvent à vaincre et à soumettre, mais jamais à gouverner, se furent livrés quelque temps à l’enivrement sauvage que l’indépendance individuelle fait naître, ils commencèrent à chercher instinctivement à refaire ce que les Français avaient détruit. On vit paraître successivement au milieu d’eux des hommes entreprenants et ambitieux. De grands talents se révélèrent dans quelques-uns de leurs chefs, et la multitude commença à s’attacher à certains noms comme à des symboles d’ordre.
Les Turcs avaient éloigné l’aristocratie religieuse des Arabes de l’usage des armes et de la direction des affaires publiques. Les Turcs détruits, on la vit presque aussitôt redevenir guerrière et gouvernante. L’effet le plus rapide et le plus certain de notre conquête fut de rendre aux marabouts l’existence politique qu’ils avaient perdue. Ils reprirent le cimeterre de Mahomet pour combattre les infidèles et ils ne tardèrent pas à s’en servir pour gouverner leurs concitoyens : ceci est un grand fait et qui doit fixer l’attention de tous ceux qui s’occupent de l’Algérie.
Nous avons laissé renaître l’aristocratie nationale des Arabes, il ne nous reste plus qu’à nous en servir.
À l’ouest de la province d’Alger, près des frontières de l’empire du Maroc, était fixée depuis longtemps une famille de marabouts très célèbre. Elle descendait de Mahomet lui-même, et son nom était vénéré dans toute la Régence. Au moment où les Français prirent possession du pays, le chef de cette famille était un vieillard appelé Mahiddin. A l’illustration de la naissance, Mahiddin joignit l’avantage d’avoir été à la Mecque et de s’être longtemps et énergiquement opposé aux exactions des Turcs. Sa sainteté était en grand honneur et son habileté connue. Lorsque les tribus des environs commencèrent à sentir ce malaise insupportable que cause aux hommes l’absence du pouvoir, elles vinrent trouver Mahiddin et lui proposèrent de prendre la direction de leurs affaires. Le vieillard les réunit toutes dans une grande plaine ; là, il leur dit qu’à son âge il fallait s’occuper du ciel et non de la terre, qu’il refusait leur offre, mais qu’il les priait de reporter leur suffrage sur un de ses plus jeunes fils qu’il leur montra. Il énuméra longuement les titres de celui-ci a gouverner ses compatriotes : sa piété précoce, son pèlerinage aux Lieux Saints, sa descendance du Prophète ; il fit connaître plusieurs indices frappants dont le ciel s’était servi pour le désigner au milieu de ses frères et il prouva que toutes les anciennes prophéties qui annonçaient un libérateur aux Arabes s’appliquaient manifestement à lui. Les tribus proclamèrent d’un commun accord le fils de Mahiddin émir-el-mouminin, c’est-à-dire chef des croyants.
Ce jeune homme qui n’avait alors que vingt-cinq ans et était d’une chétive apparence s’appelait Abd-el-Kader.
Telle est l’origine de ce chef singulier : l’anarchie fit naître son pouvoir, l’anarchie l’a développé sans cesse et, avec la grâce de Dieu et la Nôtre, après lui avoir livré la province d’Oran et celle de Tittery, elle mettra entre ses mains Constantine et le rendra bien plus puissant que ne le fut jamais le gouvernement turc qu’il remplace.
Tandis que ces choses se passaient à l’Ouest de la Régence, l’Est offrait un autre spectacle.
À l’époque où les Français prirent Alger, la province de Constantine était gouvernée par un bey nommé Achmet. Ce bey contrairement à tous les usages était coulougli, c’est-à-dire fils d’un Turc et d’une Arabe. Ce fut un hasard singulièrement heureux qui lui permit, après la prise d’Alger, de se soutenir d’abord dans Constantine avec l’appui des compatriotes de son père et plus tard de fonder son pouvoir sur les tribus environnantes à l’aide des parents et des amis de sa mère.
Tandis que tout le reste de la Régence abandonnée par les Turcs et non occupée par les Français tombait dans le plus grand désordre, une certaine forme de gouvernement se maintenait donc dans la province de Constantine et Achmet par son courage, sa cruauté, son énergie, y fondait l’empire assez solide que nous cherchons à restreindre ou à détruire aujourd’hui.
Ainsi donc, au moment où nous parlons, trois puissances sont en présence sur le sol de l’Algérie :
À Alger et sur divers points de la côte, sont les Français ; à l’Ouest et au Sud une population arabe qui après trois cents ans se réveille et marche sous un chef national ; à l’Est, un reste du gouvernement turc, représenté par Achmet, ruisseau qui coule encore après que la source a tari et qui ne tardera pas à tarir lui-même ou à se perdre dans le grand fleuve de la nationalité arabe. Entre ces trois puissances et comme enveloppées de toutes parts par elles, se rencontre une multitude de petites peuplades Kabyles, qui échappent également à toutes les influences et se jouent de tous les gouvernements.
Il serait superflu de rechercher longuement ce que les Français eussent dû faire à l’époque de la conquête.
On peut dire seulement en peu de mots qu’il fallait d’abord se mettre simplement, et autant que notre civilisation le permet, à la place des vaincus ; que, loin de vouloir en commençant substituer nos usages administratifs aux leurs, il fallait pour un temps y plier les nôtres, conserver les délimitations politiques, prendre à notre solde les agents du gouvernement déchu, admettre ses traditions et garder ses usages. Au lieu de transporter les Turcs sur la côte d’Asie, il est évident qu’on devait conserver avec soin le plus grand nombre d’entre eux ; privés de leurs chefs, incapables de gouverner par eux-mêmes et craignant le ressentiment de leurs anciens sujets, ceux-là n’auraient pas tardé à devenir nos intermédiaires les plus utiles et nos amis les plus zélés, ainsi que l’ont été les coulouglis qui tenaient cependant de bien plus près aux Arabes que les Turcs et qui pourtant ont presque toujours mieux aimé se jeter dans nos bras que dans les leurs. Quand une fois nous aurions connu la langue, les préjugés et les usages des Arabes, après avoir hérité du respect que les hommes portent toujours à un gouvernement établi, il nous eût été loisible de revenir peu à peu à nos usages et de franciser le pays autour de nous.
Mais aujourd’hui que les fautes sont irrévocablement commises, que reste-t-il à faire ? Et quelles espérances raisonnables doit-on concevoir ?
Distinguons d’abord avec soin les deux grandes races dont nous avons parlé plus haut, les Kabyles et les Arabes.
Quant aux Kabyles, il est visible qu’il ne saurait être question de conquérir leur pays ou de le coloniser : leurs montagnes sont, quant à présent, impénétrables à nos armées et l’humeur inhospitalière des habitants ne laisse aucune sécurité à l’Européen isolé qui voudrait aller paisiblement s’y créer un asile.
Le pays des Kabyles nous est fermé, mais l’âme des Kabyles nous est ouverte et il ne nous est pas impossible d’y pénétrer.
J’ai dit précédemment que le Kabyle était plus positif, moins croyant, infiniment moins enthousiaste que l’Arabe. Chez les Kabyles l’individu est presque tout, la société presque rien, et ils sont aussi éloignés de se plier uniformément aux lois d’un seul gouvernement pris dans leur sein que d’adopter le nôtre.
La grande passion du Kabyle est l’amour des jouissances matérielles, et c’est par là qu’on peut et qu’on doit le saisir.
Quoique les Kabyles nous laissent beaucoup moins pénétrer chez eux que les Arabes, ils se montrent beaucoup moins enclins à nous faire la guerre. Et lors même que quelques-uns d’entre eux prennent contre nous les armes, les autres ne laissent point de fréquenter nos marchés et de venir nous louer leurs services. La cause de cela est qu’ils ont déjà découvert le profit matériel qu’ils peuvent tirer de notre voisinage. Ils trouvent fort avantageux de venir nous vendre leurs denrées et acheter celles des nôtres qui peuvent convenir à l’espèce de civilisation qu’ils possèdent. Et, quoiqu’ils ne soient pas encore en état de se procurer notre bien-être, il est déjà facile de voir qu’ils l’admirent et qu’ils trouveraient fort doux d’en jouir.
Il est évident que c’est par nos arts et non par nos armes qu’il s’agit de dompter de pareils hommes.
S’il continue à s’établir entre les Kabyles et nous des rapports fréquents et paisibles ; que les premiers n’aient point à redouter notre ambition et rencontrent parmi nous une législation simple, claire et sûre qui les protège, il est certain que bientôt ils redouteront plus la guerre que nous-mêmes et que cet attrait presque invincible qui attire les sauvages vers l’homme civilisé du moment où ils ne craignent pas pour leur liberté se fera sentir. On verra alors les mœurs et les idées des Kabyles se modifier sans qu’ils s’en aperçoivent, et les barrières qui nous ferment leur pays tomberont d’elles-mêmes.
à suivre…
Alexis de Tocqueville (Lettre II)
Mis précédemment en ligne le 22 juillet 2005
[1] l’orthographe d’origine était Cabyles