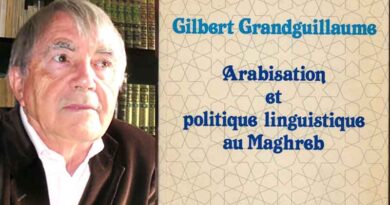Algérie analyse de Gilbert Grandguillaume
Enjeux linguistiques en Algérie
Question de la langue en Algérie
La question de la langue en Algérie est depuis longtemps l’objet de débats car elle touche à des questions importantes, telles que l’identité, la légitimité, les orientations idéologiques. À la différence de la Tunisie et du Maroc, l’Algérie était considérée comme territoire français. La population ne trouva comme référence d’identité que l’Islam, et ce qui lui était associé étroitement, la langue arabe. Or la politique coloniale n’avait fait quasiment aucune place à cette langue, ni dans l’enseignement, ni dans l’administration du pays. Aussi, dès l’indépendance, la question de la restauration de la langue arabe a été posée. Cette restauration, désignée sous le terme d’arabisation, a été l’objet d’enjeux politiques, sociaux, culturels et suscite des débats encore aujourd’hui. Nous allons d’abord expliciter ces enjeux, puis rappeler le déroulement de cette politique de 1962 à 1988, pour approfondir les débats soulevés par cette question durant la dernière décennie.
Les enjeux linguistiques
Le paysage linguistique en 1962 est largement dominé par le français. C’est la langue utilisée dans l’administration, omniprésente dans l’environnement, et diffusée dans un système d’enseignement en voie d’expansion. La langue arabe écrite, dite classique ou littérale, n’est connue que par une minorité qui l’a apprise dans des écoles coraniques traditionnelles ou rénovées dans le cadre du réformisme, et plus rarement au Moyen-Orient. Outre le français, les langues parlées sont l’arabe algérien, dit dialectal, ou le berbère dans certaines régions (notamment en Kabylie, dans les Aurès et au Mzab).
Il y avait dans l’opinion une sorte de consensus sur le fait de redonner une place à la langue arabe écrite, dite aussi coranique, dans l’Algérie indépendante. Symboliquement, l’arabe incarnait l’Islam, pôle identitaire des Algériens durant la colonisation ; dans l’opinion, le fait d’être musulman exprimait une conscience d’appartenance à la nouvelle nation aussi forte, sinon plus, que le fait d’être Algérien, comme le révéleront les débats sur la nationalité algérienne à l’Assemblée algérienne de 1962. La langue arabe avait perdu sa place de langue écrite de la société du fait de la colonisation : il semblait normal qu’elle la reprît. La restauration de la langue arabe reposait donc sur les deux piliers de légitimation du pouvoir politique : l’Islam et le combat pour la libération du pays.
Cette restauration pouvait se réaliser selon deux optiques. L’optique du monolinguisme consistait à faire prendre à l’arabe la place du français, en expulsant celui-ci au fur et à mesure de la reconquête des différents secteurs. L’autre optique, celle du bilinguisme, conduisait à développer l’enseignement de la langue arabe tout en maintenant à son côté la langue française, comme langue d’appui et d’ouverture.
La Tunisie et le Maroc adoptèrent cette seconde position. En Algérie, aucun choix officiel ne fut assumé, car la cause de l’arabisation fut dès le début un enjeu politique et social entre deux courants opposés. À défaut de pouvoir s’y opposer directement, les adversaires de l’arabisation soutinrent la politique de bilinguisme : en fait ils redoutaient à la fois la perte de leur position dans l’appareil d’État, et un « retour au xive siècle[1] », la transposition en Algérie, sous couvert d’islamisation, d’un modèle de sous-développement qu’ils repéraient au Moyen-Orient.
Les partisans de l’arabisation y voyaient un moyen facile de prendre la place des élites mises en place par la France durant la guerre d’Algérie, tout en mythifiant le Moyen-Orient : un modèle qui les obsédait au-delà de toute raison, au point de les pousser à une imitation excessive. De là vient leur position outrancière en matière d’arabisation : en voulant faire de la langue arabe classique la langue unique de la société (ce qu’elle n’est en aucun pays arabe), ils luttèrent à la fois contre le français, et contre les langues parlées, conçues comme des dégradations de la langue sacrée et des entraves à l’unité de la nation arabe ; d’où leur hostilité à l’arabe algérien et surtout au berbère.
Le substrat de ces confrontations linguistiques, ce sont deux catégories sociales en compétition, s’articulant sur deux systèmes de valeurs : pour l’une, la référence est le Moyen-Orient, l’Islam, l’unité arabe par rapport auxquels on éprouve un complexe d’infériorité lié à la francisation de l’Algérie et à son passé colonial, pour l’autre, la référence est le monde moderne incarné par la France, la langue française, objet d’un rapport ambivalent qui permettra à leurs adversaires de jouer sur leur mauvaise conscience en les qualifiant de « parti de la France », hizb fransa.
Ces deux courants coexistent au sein de la société algérienne, l’un attaché aux valeurs traditionnelles et religieuses, l’autre aux valeurs modernistes : ils s’affrontent sur le terrain de la langue, mais aussi sur d’autres thèmes : le statut personnel, la famille, la place de la femme, la source et la nature du pouvoir, et il est difficile jusqu’à ce jour de connaître leur poids respectif. Leur antagonisme empêche la mise en place des compromis que toute politique nécessite. Il est probable que le conflit traverse non seulement la société, mais aussi chaque individu. Le grand absent est la personnalité algérienne, objet de multiples refoulements : le premier lié à la colonisation, le second créé par l’action réformiste qui a rejeté la religion populaire incarnée dans les confréries, le troisième issu de l’échec du pouvoir national à assumer une personnalité algérienne authentique dans le cadre du pluralisme et de la démocratie.
Ceci permet de réaliser pourquoi tout débat, toute mesure mettant en jeu les langues se heurte à une sensibilité exacerbée, qui s’étend de la conscience identitaire au souci de l’insertion sociale par le biais de l’enseignement. Dans ce contexte, idéalisme et hypocrisie sociale ne cessent de se conjuguer, au mépris du réalisme et de l’intérêt national. C’est pourquoi, jusqu’à ce jour, les positions demeurent inconciliables.
À suivre
Grandguillaume Gilbert, enseignant honoraire à l’EHESS. Ancien responsable de la coopération culturelle à l’ambassade de France à Alger.
[1] Par référence au calendrier hégirien, expression souvent citée dans les débats de l’époque.